 Alexandre Soljénitsyne (1918 – 2008)
Alexandre Soljénitsyne (1918 – 2008)
Alexandre Soljénitsyne conclut sa chronique des camps du Goulag, son essai d’investigation littéraire, sa description du quotidien de ceux qu’on nomme aujourd’hui zeks par des récits de résistance.
En lien avec :
L’archipel du Goulag – Tome II
CINQUIEME PARTIE : Le bagne
1- Voués à la mort – En avril 1943, Staline réinventa le bagne. Le but était clair : faire mourir les détenus à petit feu en les logeant à 200 dans des bâtiments sans fenêtre de 7 mètres sur 20, conçus pour 100, en les épuisant 12 heures par jour aux travaux les plus durs, en les tourmentant par différentes tracasseries tels que des appels répétés et en ne leur laissant que quatre heures de repos. Le bagne était avant tout destiné aux traitres des zones libérées de l’occupation nazie : les femmes ayant eu une aventure avec un allemand, les hommes ayant occupé un poste à responsabilité tel que bourgmestre ou policier et, plus généralement, ceux qui avaient continué à exercer les professions de paysan, cheminot… considérées comme apportant une aide à l’ennemi. Qui étaient ces gens en vérité ? Des femmes de vingt-cinq ans lasses du puritanisme soviétique qui s’étaient laissées séduire par un soldat ou qui avaient consenti à une relation parce qu’elles avaient faim ; des hommes vivant dans le malheur depuis vingt-quatre ans qui avaient caressé le vain espoir de jours meilleurs à l’approche des troupes allemandes ; des gens qui avaient perdu leurs repères après la rupture du Pacte en 1941 et la volte face de leur gouvernement, Hitler étant jusqu’alors présenté en ami ; des familles de victimes de condamnés politiques, exécutés ou internés en camps ; des rescapés du massacre de 8 millions d’Ukrainiens de 1933 ; des citoyens désorientés devant l’incompétence de leur dirigeant, voyant progresser les troupes allemandes à une telle vitesse qu’en décembre 1941, 60 des 150 millions de soviétiques n’étaient plus sous le contrôle de Staline ; des parents de soldats voyant l’armée se replier sans se préoccuper des poches de plusieurs centaines de milliers d’hommes laissées derrière elles à la merci de l’ennemi. Dans ces conditions qui étaient vraiment les traitres ?
En 1948, fut remplacé par les camps spéciaux dans lesquels les condamnés politiques les plus graves et les anciens bagnards, furent séparés des détenus de droit communs.
2- Un zéphyr de révolution – A la moitié de sa peine, Alexandre Soljénitsyne renonça aux conditions de détention décentes qu’il était parvenu à obtenir en échange d’un travail pour les autorités. Il considérait désormais ce prix exorbitant et fut transféré vers le camp spécial d’Ekibastouz au Kazakhstan. Pendant les trois mois que dura le voyage, les manifestations de sympathie qu’il reçut de ses compatriotes renforcèrent sa conviction que la justice était de son côté, pas de celui de ses juges. Un petit vent de changement soufflait : certains prisonniers politiques répliquaient aux menaces des truands jusqu’alors tout puissants, des altercations verbales éclataient entre gardiens et prisonniers politiques qui refusaient d’être traités de traitres.
Parmi les détenus se trouvaient des Estoniens et des Lituaniens, dont les pays, paisibles avaient été annexés de force par l’Union Soviétique ; des Lettons dont l’Etat était impliqué dans la Révolution d’Octobre par la participation active de ses fusiliers ; des Ukrainiens dont les indépendantistes étaient présentés comme des bandits par le pouvoir soviétique qui caressait le vieux rêve de rassembler la Russie et l’Ukraine. Mais cette tâche à laquelle bien d’autre s’étaient attelés dans le passé restait colossale. Comment réunir des individus, issus d’un même peuple mais séparés par l’Histoire depuis le XIIe siècle, dont certains se considèrent ukrainiens, d’autres russes, d’autres enfin ni l’un ni l’autre ?
La guerre de Corée venait de commencer et un troisième conflit mondial était possible. L’avantage de l’arme nucléaire était du côté occidental mais cette éventualité n’effrayait nullement les détenus pour qui la vie était dénaturée. Ils espéraient un changement, d’où qu’il vienne et quel qu’en soit le prix.
3- Chaînes, des chaînes… – A l’arrivée, le vent du changement s’était tu. Les conditions de détentions dans les camps spéciaux, destinés aux anciens bagnards et aux détenus politiques jusqu’alors internés dans des camps de rééducation par le travail, se durcirent au fil des inventions et des idées de leurs responsables : utilisation des menottes serrées au maximum pour comprimer les poignets joints dans le dos, substitution des noms des détenus par des numéros portés à plusieurs endroits de leurs vêtement à la manière des camps nazis, nécessité de justifier par écrit toute transgression au règlement, interdiction de détenir de quoi écrire.
Dans les premières subdivisions du Steplag (camps des steppes dont faisait partie Ekibastouz), dans la région de Karaganda, les prisonniers étaient employés à extraire le cuivre à sec. Après quelques mois, atteints de silicose ou de tuberculose, ils étaient expédiés au camp de Spassk où les 15 000 invalides des camps spéciaux continuaient à travailler : construction d’une digue située à 12 kilomètres, exploitation de carrières dans le camp, renforcement des murs de clôture, construction de bâtiments à l’usage des gardiens et de leurs familles, travail aux champ et… creusement de tombes et inhumation des morts, entre 75 et 100 par jour.
Le régime disciplinaire du camp spécial était la transposition, en plus dur, de celui des camps de rééducation par le travail dont l’esprit avait été apporté par les détenus et les gardiens qui en était issus. Ceux qui refusaient de travailler étaient durement châtiés : cachot, allongement de peine… Chacun finalement essayait de tirer son épingle du jeu, qui en accédant aux postes de planqués, qui en faisant un bon travail pour être tranquille. L’atmosphère n’était pas à la révolte mais à sauver sa peau en obéissant.
Alexandre Soljénitsyne fut affecté, à sa grande honte, à une brigade chargée de terminer la construction du Bour, la prison en pierre. Pendant ce temps eurent lieu quatre tentatives d’évasions. Comment imaginer pouvoir s’évader du camp d’Ekibastouz, dans un environnement de steppes, habillé en prisonnier. Les trois premières échouèrent mais les fuyards de la suivante ne furent jamais repris.
4- Pourquoi vous êtes-vous laissé faire – Certains Historiens-Marxistes pourraient reprocher aux détenus de s’être laissés faire dans les camps. Il convient de souligner avec insistance que, depuis l’Ancien Régime, les choses avaient radicalement changé. Sous le tsar les peines étaient plus légères, les exécutions infiniment moins nombreuses, les familles des condamnées n’étaient pas décimées ni emprisonnées, les réfractaires et les évadés ne risquaient pas leur vie ni l’allongement de leur peine. La famille Oulianov par exemple dont l’un des membres, Alexandre, avait été exécuté pour avoir participé à un attentat contre le tsar, n’a aucunement été inquiétée. Lénine a pu suivre des études de droit et s’adonner à des activités politiques. Ses condamnations légères pour son engagement révolutionnaire n’ont pas été alourdies du fait du passé de son frère. L’action répressive de la police était à ce point inefficace qu’elle n’a pu éviter la chute du tsar.
Mais la différence majeure tenait dans le fait que l’opinion publique, que craignait le tsar, avait complètement disparue sous Staline. La censure de la presse veillait à ce que les informations concernant les protestations et les grèves de la faim ne sortent pas du camp. Les évasions étaient généralement vouées à l’échec, les détenus ne pouvant compter sur aucun appui extérieur et risquant même d’être dénoncés par une population apeurée. Les révoltes d’envergure qui éclatèrent pourtant n’eurent aucun écho à l’extérieur. Les quatre moyens d’action des prisonniers, protestation, grève de la faim, évasion et révolte étaient ainsi réduits à néant. Pourtant, ils ont été utilisés. Les prisonniers politiques ne se sont pas laissés faire.
5- Poésie sous une dalle, vérité sous la pierre – Alexandre Soljénitsyne s’adonna à sa passion de l’écriture malgré son interdiction stricte. Il écrivait en vers qu’il apprenait par cœur, détruisait le papier et récitait sans cesse ce qu’il avait écrit. Les cinquantièmes et centièmes lignes de chaque série, apprises séparément, permettaient de contrôler la récitation de tous les vers intermédiaires. Il se fit fabriquer un chapelet par des catholiques en leur faisant croire que sa foi l’obligeait à distinguer au toucher les dixième, cinquantième et centième grains. Il s’agissait en fait d’un outil de récitation, utilisable à tout moment, des douze mille lignes déjà composées. A trois reprises, il se fit prendre avec des manuscrits non encore mémorisés, mais les explications qu’ils donna chaque fois, suffirent à lui éviter une punition voire un allongement de peine.
Nombreux sont les mystiques et les poètes dans un camp même s’ils ne se repèrent pas tous au premier coup d’œil. Alexandre Soljénitsyne rencontra Siline, religieux autodidacte, qui avait construit sa foi et son humanisme dans les camps. Sa théodicée tenait dans le fait que le malheur permettait de mieux apprécier le bonheur. Il fit également la connaissance d’un tolstoïen qui avait, en vertu de la doctrine de son maître pourtant prisé par le pouvoir soviétique, refusé de se battre, de Messamed, un juif diplômé de l’université de Bucarest en biopsychologie et maîtrisant parfaitement le Hathayoga, d’Arnold Rappaport qui avait décidé d’écrire un mémoire technique universel en format de poche et entrepris la rédaction d’un traité de l’amour, d’un poète d’origine grecque réfléchissant à sa mort prochaine, deux jeunes poètes assumés attendant leur libération pour faire carrière dans leur art. Il fit aussi la connaissance d’un hongrois, amateur de poésie, Jànos Rozsàs, qui ne connaissait la Russie que par la fenêtre des trains de prisonnier mais qui en était tombé amoureux. De retour chez lui après la mort de Staline, il lui resta indéfectiblement attaché. Combien de poètes, combien de mystiques, combien d’hommes à la vie intérieure bouillonnante ont séjourné dans les camps ? Combien sont oubliés, morts sans que leur œuvre n’ait fait surface.
Trois rencontres furent particulièrement importantes à Ekibastouz : Georges Tenno, ancien marin, entier, athlétique, Pétia Kichkine, personnage le plus populaire du camp, bouffon capable de distiller les idées les plus rebelles sous la forme de la farce et Jénia Nikichine, personnage simple et attachant, poète clandestin.
6- Un évadé dans l’âme – Parmi les détenus des camps se trouvaient des évadés dans l’âme, des hommes qui ne pouvaient tolérer leur statut d’esclave et qui ne pensaient qu’à sortir, au mépris du danger. Leur vie de détenu était consacrée à l’observation et à la recherche d’un plan : ils comptaient les pas dans les couloirs, tentaient de se repérer dans les endroits inconnus, s’imprégnaient des récits d’évasion pour éviter les erreurs. Généralement, on ne s’évade pas dans les premiers jours qui suivent son arrestation alors que l’opération serait pourtant plus facile. On espère encore tirer les choses au clair, convaincre de son innocence. Ce n’est que lorsque la situation s’est stabilisée que l’évasion devient un impératif évident pour l’évadé dans l’âme. Il est alors prêt à risquer sa vie. Il élabore sans cesse des plans auxquels il doit renoncer au dernier moment parce qu’un malheureux hasard ou une dénonciation aura tout gâché. Georges Tenno était un évadé dans l’âme. Après plusieurs tentatives avortées ou déjouées par les gardes, il s’évada à l’automne 1950 avec un complice, Kolia Jdanok, en coupant les barbelés. Le prétexte de la répétition d’un spectacle leur avait permis de porter des habits civils et de rentrer plus tard au baraquement, avantages précieux pour leur entreprise.
7- Le chaton blanc (Récit de Georges Tenno) – Peu après leur sortie, Tenno et Jdanok virent derrière eux un feu d’artifice de fusées éclairantes qu’ils prirent pour l’alerte. Plus question de voler une voiture à la citée ouvrière voisine, il fallait disparaitre au plus vite dans la steppe. Ils sauront plus tard qu’il s’agissait d’une panne de courant et que les fusées servaient à donner de la lumière. Mauvais début. Cette sortie fut suivie d’une semaine de nuits de marche et de jours d’attente dans des trous creusés dans le sol ou sous une pierre. Une semaine sans boire ni manger qui se termina par un vol de nourriture chez des Kazakhs qui leur avait refusé l’hospitalité. Ils se dirigèrent ensuite vers Omsk, se méfiant de leur pires ennemis : leurs compatriotes. Arrivés sur les bords de l’Irtych ils volèrent une barque, dormirent dans des meules de foin. La vie matérielle était devenue plus facile mais la population devenant plus dense, les risques de dénonciation ou d’arrestation augmentaient. Alors que la chance leur souriait, Tenno renonça à dévaliser un couple qui déménageait et dont ils auraient pu prendre les papiers et l’argent : un petit chaton blanc avait frôlé ses jambes, lui rendant une humanité qu’il était sur le point de perdre. Le couple ainsi qu’un chasseur qu’ils avaient croisé les signalèrent. Tenno fut finalement arrêté trois semaines après l’évasion, dénoncé à nouveau par un gardien de balise de la rivière. Jdanok qui avait pu s’enfuir fut arrêté par la milice qui gardait l’entrée de Omsk.
8- Evasions pour moralistes, évasions pour ingénieurs – Chaque évasion des camps du Steplag était suivie d’une marche interminable. L’urgence était de trouver de l’eau puis de la nourriture. Elle se terminait presque chaque fois par une rencontre, fortuite ou pour de l’aide, dans un pays où la dénonciation était la règle et où les représentants de l’Etat étaient partout. En 1951, deux évadés tuèrent leur troisième compagnon pour boire son sang. Mais il s’était coagulé instantanément. Ils trouvèrent un puits peu après puis furent repris.
Une tentative d’évasion d’une rare intelligence eu lieu à Ekibastouz en 1951. Seize détenus sûrs d’un même bâtiment construisirent un tunnel depuis une des chambres, sans que les autres occupant n’en sachent rien. Un conduit, aménagé derrière le poêle, permettait de faire monter la terre excavée directement du sous-sol au grenier. Mais, le jour de l’évasion, alors qu’il entendait des pas au-dessus du tunnel, plutôt que d’attendre que la voie soit libre, Jdanok, qui en était à sa seconde tentative, sorti la tête et fut repéré. Tel était le lot de la plupart des évasions : après une préparation minutieuse et un travail énorme, tout s’effondrait.
9- Les fistons à mitraillette – Tout était organisé pour faire passer les détenus pour des gens dangereux et effrayants, à commencer par leurs vêtements. La population les regardaient avec crainte. Les soldats d’escorte, des gamins qui avaient souvent été recrutés contre leur gré, en ignoraient tout. Un instructeur politique leur expliquait qu’ils étaient des fascistes et des hommes dangereux, qu’il fallait faire preuve à leur égard de la plus grande fermeté et ne pas leur adresser la parole. Alors les surveillants obéissaient pour servir la patrie et respecter leur serment. Mais n’est-ce pas là le principal problème du XXe siècle : est-il admissible d’exécuter des ordres en refilant à d’autres le fardeau de sa propre conscience ? Est-il possible de ne point avoir ses propres notions du mauvais et du bon et de les puiser dans des instructions imprimées et dans les directives verbales de ses chefs ?
Ces notions étaient à ce point confuses que puisqu’on accordait un mois de congé à celui qui abattait un homme en train de s’enfuir, certains avaient la gâchette facile ou inventaient des tentatives d’évasion pour la récompense. En outre la mort de prisonniers témoignait de l’efficacité de toute une compagnie d’escorte.
10- Quand le sol de la zone brûle les pieds – Le regroupement des prisonniers politiques lourdement condamnés dans les camps spéciaux eut pour effets que les truands n’y faisaient plus la loi et que la parole y était plus libre. Que risque un condamné à 25 ans ? Les détenus n’étaient plus divisés entre planqués et trimeurs, condamnés de droit commun et condamnés politiques mais selon les origines locales, le groupe religieux, l’expérience et les connaissances acquises. Avec l’arrivée d’indépendantistes ukrainiens, l’ère des évasions allait laisser place à celle des révoltes.
Le maillon de la chaîne qui sauta au camp d’Ekibastouz fut Tuez les mouchards ! Ils étaient exécutés avec un couteau de fortune, à 5 heures du matin, lorsqu’un surveillant venait d’ouvrir les baraquements mais que le camp était encore désert. Les tueurs agissait masqués. Si quelqu’un les reconnaissait, il se taisait de peur d’être à son tour égorgé. Un air de liberté commença à souffler. La peur changea de camp. Alors qu’il n’y avait eu qu’une douzaine de meurtres, les mouchards mirent fin à leur double jeu. Les brigadiers démissionnaient ou devenaient compatissant et les autorités étaient contrainte de demander aux détenus d’en désigner eux-mêmes. Les anciens mouchards demandaient asile dans le Bour pour éviter la mort promise. La machine répressive était impuissante à combattre un phénomène soutenu par l’immense majorité des détenus. De plus, reconnaitre l’émergence d’un mouvement politique dans le camp aurait fait apparaitre les surveillants comme incompétents. La violence était qualifiée de banditisme, excluant du même coup la possibilité d’exécuter les responsables. La réponse fut donc la construction par les prisonniers, en dehors de leurs heures de travail, d’un mur séparant le camp en plusieurs parties.
11- A tâtons nous rompons nos chaînes – La parole libérée, d’autres revendications se firent jour : la suppression des pratiques humiliantes telles que la fermeture des baraquements la nuit obligeant à l’emploi de la tinette, la rémunération du travail et l’envoi de douze lettres par ans. Les moyens projetés : grève du travail, assimilable à du sabotage, légitimée par une grève de la faim. Mais au début de l’année 1952, les autorités séparèrent les prisonniers de chaque côté du mur qu’ils avaient construit. Les deux mille Ukrainiens dans le camp n° 2, les trois mille autres détenus dans camp le n° 1. Des suspects d’avoir participé à la vague d’égorgement furent envoyés au Bour pour que les mouchards les fassent parler. Un soir, des hommes du camp n° 1 démontèrent leur lit pour en récupérer les barres, attaquer le Bour et y mettre le feu. Les soldats tirèrent depuis les miradors puis pénétrèrent dans la zone en tirant encore. Les blessés et ceux qui avaient été pris hors des baraques furent considérés comme meneurs et tabassés. Le lendemain des détenus de la baraque 9 qui comptaient deux tués et trois blessés entamèrent spontanément la grève du travail et de la faim qui n’avait pu avoir lieu. Au fur et à mesure que la nouvelle se répandit, l’ensemble du camp leur emboita le pas. Pour des hommes aussi mal nourris le sacrifice et le danger étaient immenses.
La direction promit d’examiner les plaintes des détenus insinuant le doute dans les esprits malgré l’absence totale de confiance. Après quatre jours, la baraque 9 qui avait entamé le mouvement retourna au réfectoire et rompit la grève. Les autres suivirent. Puis, sous prétexte de recueillir les doléances, une commission se tint pour faire parler les détenus et identifier les meneurs. 800 hommes environ furent transférés. De nombreux Ukrainiens qui n’avaient pas été solidaires furent aussi du voyage. Les mouchards firent leur réapparition mais avec retenue. Quelque chose avait quand même bougé.
Le virus de répandit. De nombreux transférés d’Ekibastouz allèrent à Kanguir. Des mouchards y furent aussi égorgés mais des canailles cherchant leur propre profit dénaturèrent le mouvement qui ne dura pas.
Et puis les temps changèrent. Staline mourut, Béria fut déclaré ennemi du peuple laissant les officiers du MVD orphelins et dans la crainte d’être eux-mêmes inquiétés.
12- Les quarante jours de Kenguir – Après la disparition des deux bourreaux, les détenus espéraient des changements. Les officiers du MVD les redoutaient et voulaient justifier leur existence. A Kenguir, ils tuaient régulièrement et sans raison des détenus qu’ils accusaient d’avoir voulu fuir. Après l’assassinat d’un évangéliste, les zeks se montrèrent, en retour, plus menaçants, la grève étant leur arme principale. La direction eut alors l’idée, au printemps 1954, de réintroduire des détenus de droit commun dans le camp n° 3, le plus turbulent. Mais le résultat ne fut pas celui attendu. Les politiques qui s’étaient aguerris dans le combat proposèrent une alliance aux truands. En minorité de 600 contre 2600, ceux-ci acceptèrent.
Le soulèvement se produisit un dimanche soir : des truands entrèrent dans le camp de l’intendance après avoir cassé les ampoules des lampadaires à coup de pierres. Ils firent des brèches dans les murs de façon à réunir les camps n° 1, celui des femmes, ainsi que les camps n° 2, n° 3 et l’intendance. Il y eu des morts, tués par les gardes, des discussions et finalement, truands et politiques prirent le contrôle du camp. Puis l’heure vint d’élire des représentants à la « commission pour les pourparlers avec les autorités et l’autogestion » ainsi qu’aux sous-commissions. A la tête du soulèvement, le général Kouznetsov qui avait pris Berlin et dont l’attitude respectueuse envers les autorités était ambigüe. Il invita à ne pas s’opposer au pouvoir mais à revendiquer l’application stricte de la constitution et du droit soviétiques. Sage décision. La vie autogérée du camp s’organisa. Les entrées furent gardées par des barricades, des armes blanches furent fabriquées avec les barreaux des fenêtres et des pourparlers s’engagèrent avec des généraux ventripotents venus de Moscou. Les revendications des zeks étaient la punition des assassins de l’évangéliste et des fusillades, la suppression des numéros sur les vêtements, la journée de travail de huit heures, un meilleur salaire et la révision de leurs cas. Les généraux promettaient beaucoup mais convainquaient peu. Certains détenus, les orthodoxes, souhaitaient que tout cela cesse, par loyauté envers le communisme et pour retrouver leur poste de planqué.
Cette situation dura quarante jours. Personne, parmi les huit mille prisonniers, ne se faisait d’illusion sur l’issue finale. Les meneurs savaient qu’ils passeraient en jugement et ne survivraient pas longtemps à la prise du camp. Parmi les autres, certains hésitaient entre combattre ou se rendre et trahir. Ces tourments étaient attisés par la radio extérieure qui promettait la libération de certains détenus en fin de peine et l’impunité pour ceux qui sortiraient. Une petite minorité fit ce choix. Finalement l’assaut fut donné, on l’a su plus tard, lorsqu’arriva un régiment « à destination spéciale », c’est-à-dire punitif. Les prisonniers qui devaient donner l’alerte en cas d’attaque furent tués par des tireurs d’élite, puis les chars et les troupes entrèrent dans le camp le 25 juin 1954, prenant les prisonniers au saut du lit. Le nombre de tués, de façon sauvage, souvent écrasés sous des tanks, fut d’environ 700 d’après les récits des survivants. Pour éviter un décompte exact, les tombes furent creuser par les troupes. Aucune information n’est connue sur le sort des meneurs et membres de la commission, vraisemblablement fusillés.
Puis dans l’Archipel, l’étau se desserra un peu, des libérations anticipées à deux tiers de la peine furent accordées et Kenguir disparut en 1956.
SIXIEME PARTIE : La relégation
1- La relégation dans nos premières années de liberté – Sous le régime tsariste la peine d’exil existait pour les condamnés de droit commun et les opposants politiques. Malgré son apparente clémence, le déracinement se révélait pour certains plus insupportable que la prison et les conduisait jusqu’au suicide. Pourtant, les exilés pour motifs politiques étaient soumis à un régime relativement doux. Une allocation leur permettait de se loger et de se nourrir. Aucune sanction supplémentaire n’était à craindre en cas d’évasion manquée.
Supprimée de l’arsenal répressif du nouveau régime soviétique, la relégation fit sa réapparition trois ans après la Révolution pour les seuls condamnés politiques. Cette éclipse était purement pratique : il était plus facile d’exécuter les gens sur place que de les envoyer en exil. Désormais, le principal problème pour l’exilé n’était plus le déracinement mais la nourriture. Les allocations avaient diminué jusqu’à disparaitre et trouver du travail n’était pas chose aisée face à l’hostilité de la population attisée par les menaces du MVD envers ceux qui se montrerait trop proches des exilés. Sous l’Ancien Régime au contraire, les exilés suscitaient la sympathie de leurs hôtes.
Avec le temps, la relégation ne constituerait bientôt qu’une première peine et les exilés devraient faire face à de nouvelles arrestations et à de nouvelles condamnations, en camp cette fois.
2- La grande peste – La dékoulakisation qui accompagna la collectivisation de l’agriculture et la création des kolkhozes frappa 15 millions des paysans et des artisans les plus habiles, les plus courageux et les plus intelligents. Ils furent qualifiés de koulaks et envoyés en relégation, dénoncés pour leur réussite par des bons à rien jaloux. Si en 1929 et 1930, cette peste connut son maximum d’activité, elle se poursuivit au cours des années suivantes. Les koulaks furent arrachés à leur terre et, qualifiés de « migrants spéciaux », envoyés dans des terres hostiles pour y établir des « villages spéciaux. » Dans les villes étapes vers la déportation, la population avait interdiction de leur porter secours sous peine d’arrestation. Certains mouraient de faim dans les rues devant des autorités indifférentes. Les familles étaient systématiquement séparées, les hommes vers une destination, les femmes et les enfants vers une autre.
Les conditions de vie des koulaks en relégation dans des endroits hostiles était peu différente de celles des zeks. Le but était identique : l’extermination. En relégation, la garde était moins nombreuse et les zones entourées de barbelée n’existaient pas mais les condamnés devaient construire eux-mêmes leur logement pendant leurs heures de repos. En fait la vie était aussi terrible qu’en camp.
Parmi ceux qui avaient survécu, certains récupérèrent leur passeport après la mort de Staline.
3- Les rangs s’épaississent – La férocité de la relégation que subirent les paysans resta unique. Ce régime devint, dans les années 1930, une alternative moins onéreuse aux camps, permettant d’exclure de la société les anciens détenus politiques, leurs familles, les individus appartenant à une nationalité criminelle ou les anciens prisonniers de guerre. La logique qui présidait au choix entre le camp et la relégation n’était pas des plus claire. Les mutilés de guerre furent, quant à eux envoyés sur une île du Nord pour faire place nette. Les lieux de relégation constituaient, après l’URSS et l’Archipel un troisième pays, morcelé comme ce dernier.
Les conditions de vie en relégation variaient selon l’endroit : plus il était reculé, plus elles étaient dures. Mais où qu’il soit, les problèmes récurrents rencontrés par le relégué étaient liés à la nourriture, qu’il pouvait se voir refusée par la population locale, au travail qu’il avait peine à trouver même pour un salaire de misère, au logement qu’il devait souvent construire sur son temps libre, à l’obligation de satisfaire les caprices de ses chefs et de couvrir leurs abus sous peine d’être envoyé en camp. Ces tourments rendaient ténue la différence entre la vie en camp et en relégation, la comparaison étant parfois favorable à la première.
L’autonomie dont semblait jouir le relégué par rapport au zek n’était qu’apparente. L’absence, d’appel et de barbelés ne le rendait pas plus libre : une absence au travail pouvait être assimilée à une désertion et valoir une peine de camp. En outre, la section tchékiste opérationnelle veillait aux faits et gestes des relégués qui souvent finissaient leur vie en exil ou retournaient purger une nouvelle condamnation en camp.
4- La relégation des peuples – Après avoir déporté des Coréens d’Extrême-Orient vers le Kazakhstan en 1937, lors des graves tensions avec les Japonais, Staline recommença en 1940 avec les Finnois et les Estoniens de Leningrad qu’il envoya en république carélo-finnoise. Il poursuivit de façon plus poussée avec les Allemand de la Volga en 1941. Puis vint le tour des Thétchènes, des Ingouches, des Karatchaï, des Balkares, des Kalmouks, des Kurdes, des Tatares de Crimée et des Grecs du Caucase. La technique était maintenant bien rodée : des troupes prennent position de nuit dans les environs de chaque village, des officiers donnent de 12 heures à 30 minutes, selon le cas, pour que tout le monde, femmes, enfant et vieillards compris rassemble ses affaires puis monte dans un camion avant de prendre la direction de l’exil dans des wagons à bestiaux. En relégation la condition de ces populations étaient proche de l’esclavage et n’avaient rien à envier à celle des zeks : travail en mines, dangereuses et insalubres, ou pire, dans des kolkhozes, quasiment sans nourriture. Seuls ceux qui recevaient des colis de leur famille pouvaient survivre.
Alors que leurs élites avaient été envoyées en camp ou fusillées pendant la guerre, les Baltes, Estoniens, Lithuaniens et Lettons, furent frappés par des vagues de relégation de 1947 à 1951, avec la complicité de leurs autorités : les familles de condamnés, les paysans aisés, les gens indépendants d’esprit furent les premières victimes de ces déportations.
Les peuples exilés ne réagissaient pas de la même façon : les Allemands de la Volga s’installèrent avec facilité sur leurs nouvelles terres et dans leur nouvelle vie. Idem les Grecs. En revanche, les Tchétchènes restèrent insoumis et fiers. Les autorités soviétiques ne purent jamais en faire des esclaves.
5- Du camp à la relégation – Chaque zek rêvait de voir converties ses années de camp en relégation. Alexandre Soljénitsyne n’avait pas prévu que sa peine de prison serait suivie par la relégation à perpétuité. Libéré du camp avec quelques jours de retard, il fut envoyé à Kok Térek au Kazakhstan. Comme souvent, le voyage fut l’occasion de rencontres. Son chemin croisa celui d’un vieil ingénieur hydraulicien, Vladimir Alexandrovitch Vassiliev, condamné à 15 ans pour « nuisance » avant d’avoir pu réaliser son projet d’irrigation de la vallée du Tchou.
Soljénitsyne loua une petite maison au sol en terre battu, si basse qu’il ne pouvait y tenir debout. Il chercha sans succès un travail d’enseignant en mathématiques ou en physique. Quelques jours après son arrivée vint la bonne nouvelle : les haut-parleurs de la place de Kok Térek annoncèrent la mort de Staline.
6- La bonne petite vie de relégué – Soljénitsyne se vit proposer un travail consistant à calculer des remises de prix dans une coopérative de consommation puis l’inspection académique changea d’avis et l’embaucha à l’école qui ne disposait en réalité d’aucun professeur bon niveau. Ses cours furent l’occasion d’un bonheur partagé par des élèves captivés et par un professeur ayant retrouvé le plaisir d’enseigner. Il disposait en outre d’une heure par jour et de ses dimanches pour écrire tout ce qu’il avait mis au point dans sa tête, au camp. Sa seule souffrance était de ne pas avoir rencontré l’âme sœur.
De façon générale, les relégués dans le sud du Kazakhstan étaient privilégiés : ils arrivaient dans des villes déjà construites où les besoins de main d’œuvre étaient importants et la nourriture bon marché.
Progressivement, avec l’arrivée au pouvoir de Khrouchtchev, le régime de relégation s’adoucit : plus besoin de pointer régulièrement pour attester de sa présence, moins de mépris pour les exilés. Enfin vint l’époque des amnisties, discrètes vis-à-vis du monde extérieur autant qu’inattendues dans les camps. Les nations qui avaient été emprisonnées étaient progressivement libérées. Puis vint le tour de prisonniers politiques. Suite à une demande en révision, le cas de Soljénitsyne fut réexaminé et il fut libéré à Moscou.
7- Les zeks en liberté – La libération n’est pas la bénédiction qu’on pourrait croire, bien des tourments l’accompagnent : trouver du travail et un lieu de résidence avec un passeport trahissant son passé, des anciens amis qui se détournent, la crainte d’une nouvelle arrestation. Le plus sage est souvent de rester comme travailleur libre sur son lieu de détention. De la même façon, la situation du zek réhabilité est précaire.
Parmi ceux qui avaient enduré avec courage la vie du camp certains se laissent dépérir. D’autres, comme Alexandre Soljénitsyne, retrouvent une nouvelle jeunesse. Certains reprennent la vie qu’ils avaient laissée, pardonnent, oublient, récupèrent leur carte du parti s’ils ont été réhabilités et font comme si rien ne s’était passé. D’autres sont réticents à se réinstaller dans la vie, conscients de leur situation fragile, hantés par les années de camps. Les pages qu’ils écrivent, les liens quasi familiaux qu’ils tissent avec d’anciens zeks pour évoquer leurs souffrances passées ne suffisent pas à les libérer de leurs cauchemars.
Les retrouvailles sont aussi une épreuve. Dix ou vingt ans de séparation ont transformé les époux en étrangers, les enfants ne reconnaissent plus leur père, la vie a passé, tant de choses les séparent. Un ancien condamné peut retrouver un de ses anciens bourreaux, un responsable de camp, un commissaire instructeur, le voisin qui l’a dénoncé. Il peut même être amené à devoir le côtoyer régulièrement dans le cadre de son travail. Mais le système judiciaire soviétique est ainsi fait que ces gens ne risquent rien. Les peines pour les dénonciations mensongères sont dérisoires et la prescription les a définitivement mis à l’abri.
SEPTIEME PARTIE : Staline n’est plus
1- Coup d’œil par dessus l’épaule – Quand parut « Une journée d’Yvan Denissovitch », une faille s’était ouverte dans le mur dissimulant l’Archipel. Pour la combler le pouvoir mit en œuvre trois stratégies. La première consista à organiser une agitation d’où sorti le message suivant : il y a eu des horreurs sous Staline mais grâce au parti, tout cela appartient au passé. Gloire au parti ! La deuxième consista à publier des livres d’orthodoxes, anciens des camps, souvent des planqués, en leur demandant de déformer la vérité : les crimes étaient le fait de crapules, des vlassoviens ou des indépendantistes ukrainiens, les victimes étaient les vrais communistes. La troisième était une invitation à oublier un sujet qui était désormais définitivement du passé. Mais, l’Archipel était toujours là, son administration, ses agents d’exécution comme ils se nommaient eux-mêmes, n’avaient pas changé. Alexandre Soljénitsyne qui s’était presque laissé endormir reçut des lettres, passées sous le manteau, de zeks qui témoignaient de leurs souffrances. « Une journée d’Yvan Dénissovitch » fut vite retiré des bibliothèques mais continua à circuler clandestinement, notamment dans les camps.
2- Les gouvernants passent, l’Archipel demeure – Après la disparition de Staline et de Béria les camps spéciaux, établis sur le modèle du bagne, perdirent les particularités qui les distinguaient des camps de rééducation par le travail : plus de barreaux aux fenêtres, plus de verrouillage des baraquements la nuit, bons d’achats remplacés par de vrais roubles. On peut considérer qu’en 1954 les camps spéciaux avaient disparu. Dans les deux années qui suivirent un vent de libéralisme souffla : les prisonniers pouvaient se rendre en ville et espérer une libération anticipée. Ces évolutions inquiétèrent grandement les agents d’exécution dont le rôle s’estompait. Ils firent pression du Khrouchtchev qui passa à côté d’une occasion historique de libérer son peuple alors qu’il en avait le pouvoir. Il fit marche arrière, renforça la discipline dans les camps et préféra se consacrer à la conquête spatiale et aux missiles de Cuba. Les gouvernants changent, l’Archipel demeure. Il demeure parce que CE REGIME-LA ne saurait subsister sans lui. S’il liquidait l’Archipel, il cesserait lui aussi d’EXISTER.
Les évolutions ne furent que cosmétiques. Les prisonniers politiques dans ces camps, désormais appelés colonies, furent moins nombreux. Le MDV devint le Moop et quatre régimes carcéraux : général, renforcé, sévère et spécial, furent créés. Les cours suprêmes des républiques, en marge de toute légalité, établirent une correspondance entre les articles du code pénal et chaque régime carcéral. Des hommes désescortés ou autorisés à vivre en dehors des camps virent leur cas réexaminé sur la base de ces nouvelles règles et certains durent y retourner. L’argent fut à nouveau remplacé par des bons, le chantage à la faim réapparut : ration alimentaire fonction de la quantité de travail fournie, privation de cantine ou de colis pour mauvaise conduite. Le froid et la privation de vêtement redevinrent une arme, avec la tuberculose comme perspective. Les vexations de toutes sortes firent leur retour notamment en régime spécial : vêtements rayés, bouclage des baraques la nuit et grillage aux fenêtres. Enfin, un décret réinstitua la peine de mort pour menaces, qualifiées de terrorisme, sur les surveillants ou les mouchards. Les choses étaient redevenues comme avant.
Alexandre Soljénitsyne prit la décision d’aller rencontrer les autorités pour défendre les zeks dont il recevait toujours les nombreuses lettres. Son prix Lénine lui donnait le poids nécessaire pour cette démarche, même s’il lui fallait choisir ses arguments et ses termes avec diplomatie. Il rencontra les membres de la commission des propositions de lois du Soviet Suprême qui le contredirent sur presque chaque point : les zeks n’ont pas faim, on jette du pain ; l’augmentation du nombre de colis ne profiterait qu’aux familles riches ; la limitation des achats à la cantine du camp permet aux zeks d’avoir un pécule pour le jour de leur libération et ne pas vivre au crochet de l’Etat ; le repos dominical et l’augmentation du nombre de lettres sont prévus dans le nouveau code du redressement par le travail, en préparation. Rien n’a avancé. Lors de son entrevue avec le ministre du maintient de l’ordre public, celui-ci est d’accord avec la plupart de ses demandes mais leur satisfaction relève de l’autorité de la commission des propositions de lois. Temps perdu. Enfin, après un entretien insipide avec des représentants de l’institut d’étude des causes de la criminalité, il en rencontre le directeur qui lui apporte enfin de vrais réponses : le niveau de vie des détenus ne peut être amélioré car il serait supérieur à celui des travailleurs libres. Le nombre de colis ne peut être augmenté car les gardiens n’en reçoivent pas. De plus, sanctionner leurs exactions est impossible, personne ne veut exercer ce métier. Appliquer aux détenus le principe socialiste du paiement du travail n’est pas justifié puisqu’ils se sont mis en marge de la société socialiste. Enfin, le camp n’est pas fait pour rééduquer. Le camp est un châtiment !
3- La loi aujourd’hui – Les promesses de Khrouchtchev de mettre un terme définitif aux crimes d’Etat n’auront été que des mots, comme en témoigne la terrible répression de Novotcherkassk près de Rostov-sur-le-Don, le 2 juin 1962. Elle mériterait la même place dans les manuels scolaires que le dimanche rouge du 9 janvier 1905. Dans l’usine de locomotive de Novotcherkassk, la concomitance fortuite de l’augmentation de la viande et du beurre décrétée par Khrouchtchev et d’une baisse des salaires annoncée par le directeur conduisit à un grand rassemblement sur la place principale de la ville. Les soldats arrivés en urgence, tirèrent en l’air pour disperser la foule, tuant des enfants qui avaient pris place dans les arbres. L’émoi qui suivit fut réprimé par des tirs sur les manifestants avec des balles explosives. Bilan : 70 à 80 tués. Ceux qui convergèrent le soir venu sur cette même place furent dispersés sans ménagement par des tanks et des soldats armés de mitraillettes. Le 3 juin, tout était redevenu normal.
Certes, il n’y avait presque plus de prisonniers politiques. Ils avaient été remplacés par des détenus de droit commun. Désormais, la participation à une émeute ou la pratique trop exclusive d’une religion relevaient du droit commun. La justice avait évolué mais pas son caractère arbitraire. Les dénonciations portaient à présent sur des crimes tels que le viol. Comme avant, toute instruction commencée devait se terminer par une condamnation, quitte à intimider les témoins. Le commissaire instructeur aurait-il travaillé pour rien ? La procédure d’appel n’était pas envisageable. La justice aurait-elle pu se tromper ? Dans les cas extrêmement rares où de faux témoins étaient confondus, ils ne risquaient absolument rien. Et pour soigner les statistiques, le premier type simple et apeuré amené au poste pouvait se retrouver accusé de différents crimes et délits restés non-élucidés.
Un nouveau code pénal fut institué en 1961 mais il n’apporta pas la justice. L’accusation de parasitisme fut inventée, permettant d’arrêter et de déporter avec la souplesse de l’ancien article 58-10. La durée des peines prévues ne dépassait pas 15 ans mais les prisonniers qui purgeaient 25 ans n’eurent aucune remise de peine.
En URSS, seuls des cercles d’acier maintiennent l’Etat en place mais la loi n’existe pas.
Citations :
- En combien d’êtres différents peut se muer un seul et même homme au cours de sa vie ! Comme il est nouveau à chaque fois pour lui-même et pour les autres !
- La seule chose simple qu’il y ait la dedans, c’est cette vérité refusée plus violemment que toute autre par notre société : que le tronc nourricier qui monte du plus profond de notre vie est la conscience religieuse et non la conscience idéologique formée par le parti.
- Les gouvernants changent, l’Archipel demeure. Il demeure parce que CE REGIME-LA ne saurait subsister sans lui. S’il liquidait l’Archipel, il cesserait lui aussi d’EXISTER.
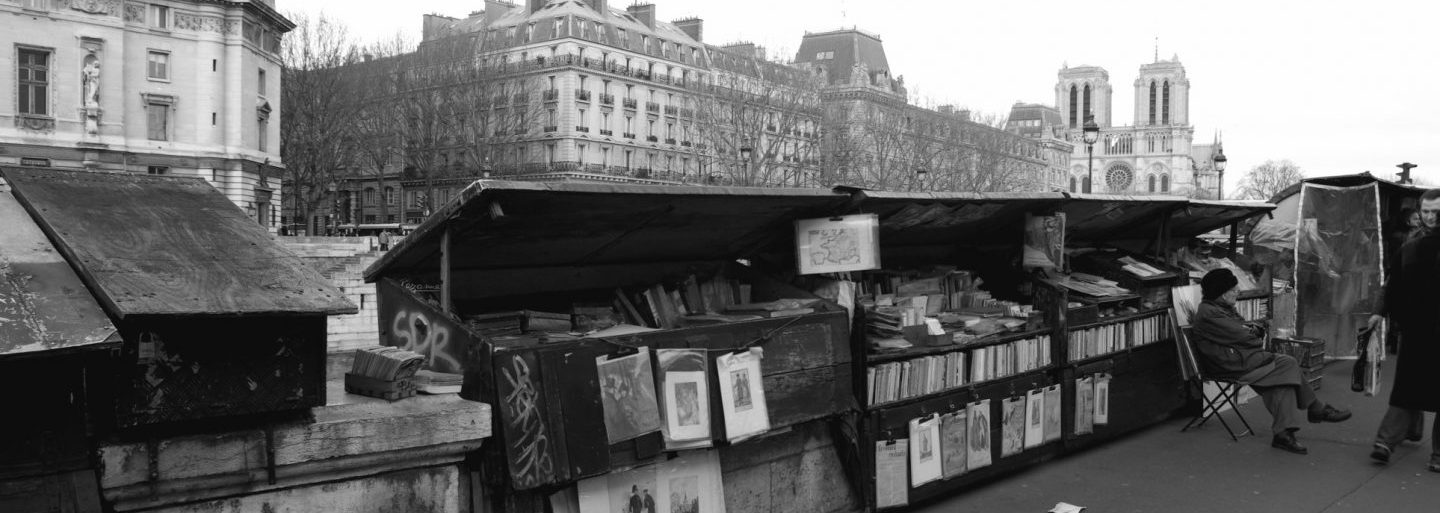

[…] L’archipel du Goulag – Tome III […]
J’aimeJ’aime
[…] L’archipel du Goulag – Tome III […]
J’aimeJ’aime
[…] L’archipel du Goulag Vol. 1, vol.2, vol.3 […]
J’aimeJ’aime