 Richard Dawkins
Richard Dawkins
Il parait nécessaire avant tout de lever un malentendu. Le propos de l’auteur n’est pas l’éloge de l’égoïsme et encore moins de donner une caution scientifique à un comportement égoïste. Il s’agit de décrire le mode de transmission des gènes et de constater qu’il peut être qualifié d’égoïste bien que les gènes n’aient aucune volonté consciente et soient le jouet de leurs propriétés chimiques. Richard Dawkins décrit, dans la logique d’un darwinisme généralisé, la façon dont il conçoit l’émergence et le développement de la vie sur terre. La théorie du gène égoïste est une alternative à la Genèse qui lui a valu les foudres des créationnistes déconcertés.
Le gène égoïste – Résumé – Richard Dawkins
Le propos va porter sur l’évolution par la sélection naturelle découverte par Darwin, en se plaçant non plus au niveau du groupe ni de l’individu mais au niveau des gènes. Dans ce contexte, une entité est dite altruiste si elle augmente le bien être, défini comme les chances de survie, d’une autre entité de même type au dépend du sien. L’égoïsme consiste dans le comportement opposé.
Deux écoles s’affrontent en matière d’évolution. La première considère que l’unité de sélection naturelle est constituée par le l’individu. Aux yeux de la seconde, cette sélection s’exerce sur le groupe. Ses membres sont alors supposés se comporter les uns envers les autres de façon altruiste dans l’intérêt commun. Cette théorie rencontre toutefois des difficultés majeures : le groupe correspond-il à la horde, à l’espèce, au genre, à l’ordre ? De plus, dans un groupe composé pour l’essentiel d’individus altruistes, les rares égoïstes sont ceux qui ont le plus de chance de vivre longtemps, de se reproduire, de diffuser leurs gènes et avec eux l’égoïsme, ce qui remet en cause l’hypothèse de départ. Il existe une troisième voie qui suppose que la sélection naturelle se joue au niveau des gènes. Elle est l’objet du livre.
Le gène égoïste – Résumé – Richard Dawkins
Pour mieux appréhender la théorie de l’évolution darwinienne, il faut tenter de comprendre comment la vie a pu apparaître sur notre planète. On peut supposer la présence sur Terre des molécules simples trouvées en abondance sur d’autres planètes : méthane, ammoniac, eau, dioxyde de carbone. Une « soupe » contenant ces molécules, exposée à la lumière ou à des étincelles électriques tel que la foudre peut en produire, conduisit à la formation de molécules plus complexes, notamment des acides aminés, constituants de base de la vie terrestre.
Puis apparut, par accident, une molécule remarquable, un réplicateur, capable de produire par affinité chimique des copies d’elle-même lorsque les composants adéquats arrivaient à sa portée. La copie faisait à son tour des copies et ainsi de suite. Cet accident originel peut s’expliquer, malgré sa haute improbabilité, par les innombrables possibilités offertes dans la soupe primitive présente sur Terre.
Des erreurs, lors du processus de réplication, ont donné naissance à plusieurs variétés de réplicateurs, tous issus d’un même ancêtre. Certaines variétés sont devenues plus nombreuses en fonction de trois caractéristiques majeures :
- leur capacité à durer ou stabilité,
- leur vitesse de reproduction ou fécondité,
- la précision des copies effectuées ou fidélité.
Puis s’installa une compétition entre les réplicateurs du fait de la quantité limitée des éléments nécessaires à la fabrication de leurs copies. Seuls se sont multipliés ceux dotés des qualités précitées et qui en outre pouvaient affaiblir la stabilité des autres afin de rendre à nouveau disponibles leurs constituants. Les erreurs de copies dues au hasard, dotèrent certains réplicateurs de caractéristiques qui se révélèrent des protections efficaces. Les concurrents qui n’en étaient pas dotés furent détruit. Ces dispositifs, de plus en plus sophistiqués, aboutirent aux machines à survie que sont les organismes vivants. Aujourd’hui, les réplicateurs ont évolué pour devenir des gènes dont nous sommes les machines à survie. Bien entendu cette évolution et cette compétition ne sont pas intentionnelles de la part des réplicateurs. Elles résultent de processus chimiques.
Le gène égoïste – Résumé – Richard Dawkins
Les gènes sont inscrits sur les molécules d’ADN qui constituent les chromosomes. Chez l’homme, ils sont au nombre de 46 répartis en 23 paires. Cette écriture est réalisée en continu en utilisant 4 bases ou nucléotides A, T, C, G (adénine, thymine, cytosine, guanine). Chaque information unitaire ou cistron est située entre un code de début et un code de fin.
Lors du renouvellement cellulaire, le processus de mitose permet une copie exacte des informations dans les chromosomes des nouvelles cellules. Lors de la fabrication des cellules sexuelles, la méiose, les chromosomes de chaque paire sont séparés puis placés dans des spermatozoïdes ou des ovules. Un enfant, issus de la fécondation d’un ovule par un spermatozoïde reçoit donc, pour chacune de ses paires, un chromosome de son père et un chromosome de sa mère. Mais pendant la méiose se produit chez chacun des parents un phénomène d’échange physique de séquences entre chromosomes de la même paire, appelé crossing over, ainsi que d’autres processus de mélange des informations génétiques. Un enfant ne recevra donc pas intact les chromosomes de ses grands parents.
Le mot gène est souvent employé pour désigner un cistron mais ici un gène peut être défini comme une portion de matériel chromosomique qui dure potentiellement pendant un nombre suffisant de générations pour servir d’unité de sélection naturelle.
Les grandes unités génétiques contenant de nombreux cistrons sont susceptibles d’être altérées par des crossing over et d’autres processus d’échange. En revanche, les petites unités, contenant quelques cistrons, peuvent vivre des millions d’années quittant un corps pour un ou plusieurs autres sous forme de copie.
Ainsi, du fait du brassage des gènes à chaque génération, les individus ne constituent pas une entité stable à l’échelle de l’évolution. En revanche le gène possède cette stabilité. Il peut donc servir d’unité de sélection naturelle.
Par ailleurs, l’effet d’un gène dépend de son environnement et des autres gènes présents. En effet, les avantages que peut conférer un gène sont susceptibles d’être anéantis par les effets des autres gènes ou par un contexte peu propice. Un gène correspondant à des dents très affutées chez un herbivore aura un effet néfaste alors qu’il aurait été un atout chez un carnivore. Mais malgré les revers que peut subir un bon gène dans certains corps, il ne disparaitra pas car ses effets s’exprimeront dans tous les corps où il est présent et son destin sera, en moyenne, meilleur que celui d’un mauvais gène.
Après avoir envisagé le gène en tant qu’unité de sélection naturelle, on peut se demander pourquoi les être vivants sont mortels contrairement à leurs gènes. Plusieurs théories existent sur les raisons pour lesquelles nous mourrons de vieillesse. La plus classique est que nous accumulons depuis notre jeunesse les erreurs de copies génétiques des mitoses successives de nos cellules. Une autre hypothèse, formulée par Peter Medawar, est qu’au fil des générations, les mauvais gènes qui se sont transmis sont en général ceux qui provoquent des effets néfastes non pas dans la jeunesse d’un individu mais à un âge qui lui a permis de se reproduire et de transmettre ses mêmes gènes qui agiront à leur tour tardivement sur sa descendance. La métamorphose d’une chenille en papillon doté du même patrimoine génétique illustre l’action retardée de certains gènes. Dans cette logique, s’il était interdit aux humains de se reproduire avant quarante ans, seuls les gènes agissant après cet âge seraient transmis et l’espérance de vie s’allongerait en quelques siècles. Enfin, il est envisageable de tromper les gènes en découvrant ce qui les renseigne sur l’âge de leur hôte afin d’intervenir sur ce paramètre et qu’ils n’entrent pas en action.
Par ailleurs, à quoi servent la reproduction sexuée et le crossing over alors que ces modes de reproduction ne sont pas généraux dans la nature et qu’ils ne sont pas très efficaces puisqu’un enfant ne reçoit que 50 % des gênes de chacun de ses parents ? On peut tout d’abord y voir un avantage pour le gène qui détermine la reproduction sexuée au dépend des autres gènes avec qui il est en compétition. De même pour le crossing over bénéficie au gène qui le contrôle. Mais plus généralement, le pool génique dans lequel l’évolution modifie la présence de certains gènes est l’équivalent de la soupe primitive présente sur terre il y a plusieurs milliards d’années. La reproduction sexuée et les crossing over permettent un très grand nombre de combinaisons permettant aux gènes de multiplier leurs chances de durer et interdisant le transfert à l’identique le patrimoine génétique. D’autres avantages seront développés dans la suite.
Le gène égoïste – Résumé – Richard Dawkins
Les gènes contrôlent les êtres vivants à la façon d’un programmateur qui a appris les échecs à un ordinateur et qui ne peut plus intervenir une fois la partie commencée. Les programmes d’échecs n’envisagent pas toutes les possibilités pour choisir le meilleur coup à jouer. Ils contiennent des stratégies associées à une certaine pondération que l’ordinateur peut éventuellement faire évoluer en fonction des parties déjà jouées. De même les gènes, dont le seul moyen d’action est la synthèse de protéines, construisent des machines à survie dotées de capacités d’adaptation diverses.
Contrairement aux plantes qui se nourrissent sur place, les autres machines à survie que sont les animaux ont développé une capacité de mouvements coordonnés, en phase avec les événements extérieurs. Pour ce faire, des neurones sont apparus, dotés de dizaines de milliers de connexions, capables pour certains de transmettent des informations d’un bout à l’autre du corps grâce à des axones de plusieurs décimètres regroupés en câbles appelés nerfs. D’autres neurones possédant des axones courts constituent le cerveau. Certains nerfs sont chargés d’apporter des informations au cerveau sur la situation extérieure ou de transmettre les ordres de mouvement émanant du cerveau vers les muscles.
L’apparition de la mémoire permettant d’augmenter les capacités d’adaptation et d’apprentissage a été une nouvelle étape dans l’évolution des machines de survies de type animal qui ont ensuite été dotées de la capacité de prévoir par simulation à partir d’un nombre de paramètres sélectionnés. Il est ainsi devenu possible d’éviter les erreurs fatales contre lesquelles la mémoire et l’apprentissage sont sans effet. La capacité de simulation trouve sa forme la plus aboutie dans l’émergence de la conscience qui reste encore aujourd’hui un mystère. La théorie de Humphrey l’attribue au travail d’introspection réalisé par les animaux sociaux dans un environnement où il faut intégrer et prévoir le comportement de ses semblables. Elle pourrait également être le résultat de l’intégration de l’individu dans le modèle qu’il se fait de son environnement.
Les observations montrent que la programmation des machines à survie par les gènes pourrait se résumer à : faites ce qui vous semble préférable pour nous maintenir vivants, formule qui présente l’avantage de la concision et de la simplicité. D’une façon générale, les gènes définissent la politique générale, le cerveau exécute.
Une expérience réalisée sur des abeilles apporte des informations sur la façon dont un comportement altruiste peut-être inné. Lorsqu’une épidémie d’une maladie infectieuse appelée pourriture du couvain touche les larves de la ruche et met en péril la survie de ses membres, certaines races abeilles débouchent les cellules contenant les larves atteintes et les expulsent à l’extérieur. D’autres races ne le font pas ce qui peut conduire à l’infection générale.
Il apparait que :
- le comportement sanitaire est conditionné par deux gènes qui correspondent, l’un au débouchage des cellules, l’autre à l’expulsion des larves malades,
- l’existence d’un lien entre un gène et un comportement, toutes choses étant égales par ailleurs,
- la nécessité pour les gènes de coopérer afin d’être efficaces, l’expulsion sans le débouchage ou le débouchage sans l’expulsion étant sans effet.
La communication entre animaux est un autre des nombreux moyens qui est apparu pour leur permettre de vivre et de transmettre leurs gènes. Des systèmes de communication ont été mis au point à l’intérieur de certaines espèces. Toutefois, alors que ces techniques visaient le bénéfice de l’émetteur et du destinataire, des moyens de tromper les interlocuteurs sont apparus afin qu’une tierce partie en tire un avantage. Cette tromperie peut émaner d’une autre espèce ou de la même espèce. Chez les humains, cela s’appelle le mensonge.
Le gène égoïste – Résumé – Richard Dawkins
L’agression fait partie des comportements animaux qui conditionnent la transmission des gènes. La sélection naturelle favorise les gènes qui programment leurs machines à survie pour qu’elles s’adaptent au mieux à leur environnement, à leurs conditions de vie et à leurs relations avec les animaux de la même espèce et d’espèces différentes.
John Maynard-Smith a inventé, à partir de la théorie mathématique des jeux, le concept de Stratégie Evolutionnairement Stable (SES). Une stratégie consiste en un comportement du type Attaquer l’ennemi. S’il s’enfuit, le poursuivre. S’il contre attaque s’enfuir ou Si l’adversaire est plus grand, fuir. S’il est plus petit, attaquer. Une SES est une stratégie qui, si elle est adoptée par la majorité des individus ne peut être améliorée par aucun individu mutant. La récompense de sortir vainqueur de ces affrontements est la survie, la reproduction et ainsi la transmission de ses gènes.
Par exemple, dans une population où :
- la majorité des individus refuse tout combat, un mutant agressif gagnera la plupart des faces à faces qu’il engagera. Il se reproduira et ses gènes de l’agressivité se répandront au fil des générations conduisant la population vers une attitude plus belliqueuse : le refus de tout combat n’est donc pas une SES.
- la majorité des individus attaquent les plus petits et fuient devant les plus gros, les combats pourront être généralement évités. Si un individu mutant en attaque un plus gros que lui, il sera vite éliminé et ne pourra transmettre ses gènes. Fuir devant les adversaires plus grands et attaquer les plus petits est une SES.
Il est possible, par modélisation, de faire s’affronter différentes stratégies, telles que celles précédemment définies, et d’examiner l’évolution de chacune d’elles sur une longue période et sur un grand nombre de générations. Ces modélisations attribuent des points à chaque événement tel que combat gagné, combat perdu, perte de temps, désertion. Ces points correspondent à une capacité de transmission des gènes pour un individu. L’exercice consiste à chercher une éventuelle SES constituée d’une des stratégies initiales ou d’un mélange pondéré de plusieurs d’entre elles dans la population étudiée, désigné par polymorphisme stable. Dans ce dernier cas, le résultat peut correspondre indifféremment à des proportions d’individus agissant en permanence selon une des stratégies initiales ou à des proportions de réactions de chaque individu conformément à certaines de ces stratégies.
La théorie des SES explique ainsi la rareté du cannibalisme par le fait qu’il génère des risques importants pour les individus et qu’il ne peut pour cette raison constituer une SES. Par contre, du fait des dissymétries, la consommation d’animaux d’autres espèces peut en constituer une, pour le chasseur comme pour le chassé.
La notion de SES trouve également des applications dans le monde des gènes. Le pool génique constitue un ensemble évolutionnairement stable, regroupant des gènes sélectionnés pour leurs qualités mais surtout pour leurs capacités à travailler ensemble. Généralement un gène mutant en est éliminé. Il arrive toutefois qu’un gène nouveau puisse se répandre et faire évoluer le pool génique avant qu’il ne retrouve sa stabilité. Un palier d’évolution aura alors été franchi.
Le gène égoïste – Résumé – Richard Dawkins
Les individus d’une même famille ont en commun un certain nombre de gènes en plus de ceux couramment répandus au sein de l’espèce. Un enfant reçoit 50 % des gènes de son père et 50 % de ceux de sa mère. Son degré de parenté à chacun ses parents directs sera donc de 1/2. De même, si un individu possède un gène donné, son frère aura une chance sur deux que le parent qui le possède lui ai également transmis. Le degré de parenté entre frères et sœurs est donc aussi de 1/2 même si cette proportion peut varier suite aux aléas du crossing over. Entre deux jumeaux elle est de 1. Pour calculer le degré de parenté entre deux individus on parcourt l’arbre généalogique de l’un à l’autre en passant par l’ancêtre commun. Partant de 1, à chaque fois que l’on monte ou que l’on descend d’un étage on multiplie le résultat précédent par 1/2. S’il existe deux ancêtres communs tels qu’une grand-mère et un grand-père, on multiplie le résultat par 2. Deux cousins germains issus de deux grands-parents communs auront un degré de parenté de (1/2)^4 x 2 = 1/8.
On remarque dans le monde animal un altruisme fonction du degré de parenté, c’est-à-dire de la part de gènes communs entre les individus. Le gène ne désigne pas ici un morceau d’ADN mais une information ayant pour support l’ADN présent dans différents corps. Cet altruisme intra-familial, appelé sélection par la parenté, est une conséquence de la sélection par le gène. La programmation des machines à survie par certains gènes pour favoriser les membres de leur famille selon leur degré de parenté vise l’augmentation du nombre des gènes communs dans le pool génique.
On pourrait calculer le bienfait pour les gènes d’une action de sacrifice d’un individu au profit des membres de sa famille en faisant la somme du nombre des individus sauvés multiplié par leur degré de parenté. Si ce nombre est supérieur à 1 qui est le coût du dit sacrifice, l’opération est bénéfique mais négative dans le cas contraire. Cette tendance générale est toutefois contrariée par plusieurs interférences :
- l’assurance de la proximité génétique : le fait que la relation entre parent et enfant est plus forte que la relation entre frères et sœurs, malgré un degré de parenté identique de 1/2 voire de 1 pour des jumeaux, peut s’expliquer par la plus grande certitude d’un lien de filiation que de fraternité. De même, la proximité d’une mère et de son enfant peut s’expliquer par une certitude de filiation que le père ne peut partager,
- l’espérance de vie ou de reproduction du bénéficiaire : un individu sera plus altruiste envers ses enfants qu’envers ses parents, malgré le même degré de parenté de 1/2, dans la mesure où ces derniers seront moins à même d’assurer la transmission des gènes aux générations futures,
- la dissymétrie de besoins : un enfant a besoin de ses parents pour commencer sa vie alors que des adultes ont moins besoin de l’aide de leurs enfants.
Ces biais dans la logique purement génétique montrent qu’il ne faut envisager de comparer l’action des gènes que toutes choses étant égales par ailleurs. De tels calculs ne sont bien sûr effectués de façon précise et consciente ni chez les animaux ni chez les humains. La sélection des gènes a permis de programmer les individus avec des règles telles que soyez gentils avec vos parents ou occupez vous de vos enfants. Des constats anthropologiques ont permis de confirmer des comportements altruistes indexés sur le degré de parenté.
L’altruisme parental s’est traduit aussi niveau physiologique par l’apparition de glandes sécrétrices de lait ou de poches chez les kangourous.
Cette logique de sélection par la parenté pourrait expliquer, outre le lien privilégié entre la mère et ses enfants, les préjugés raciaux ou l’instinct de conservation puisque nous ne sommes absolument certain que de notre propre identité.
Le gène égoïste – Résumé – Richard Dawkins
Les décisions en matières de reproduction dépendent, d’une part, du nombre de petits que la mère peut pondre ou porter et, d’autre part, de la capacité des parents à les nourrir voire à les élever pour qu’ils atteignent l’âge adulte et puissent à leur tour se reproduire. Aussi les animaux régulent leur taux de natalité en fonction du contexte, notamment de ce qu’ils savent du nombre de leurs congénères et de l’abondance prévisible de la nourriture pour le prochain printemps. Le but est d’avoir le nombre optimal de petits, c’est-à-dire le plus grand nombre qui puissent être nourris et élevés. Dépasser ce chiffre conduirait une femelle à avoir moins de descendants atteignant l’âge adulte, donc moins de petits enfants, qu’une autre l’ayant respecté. Chez certains oiseaux, les fous ou les guillemots, ce nombre est de 1. Il est déterminé une fois pour toute. Chez d’autres espèces, il varie dans une certaine fourchette en fonction des circonstances.
La théorie de la sélection par le groupe et celle du gène égoïste s’opposent sur les raisons de cette régulation. Pour la première, elle est réalisée par les individus pour le bien du groupe. L’évaluation de la densité de population peut se faire au moyen des grands rassemblements qui ont lieux chez certains oiseaux et certains insectes, ou lors de la vie en troupeaux. La sélection naturelle serait favorable aux espèces dont les membres serait capables de se sacrifier en limitant leur fécondité lorsque les circonstances l’exigent. Un des arguments en faveur de cette théorie de sélection par le groupe est lié à l’observation de certaines espèces d’oiseaux dans lesquelles les mâles luttent pour avoir un territoire ou une position sociale élevée leur donnant droit à une femelle. Ceux qui n’obtiennent pas de territoire ou qui restent au bas de l’échelle acceptent alors de ne pas se reproduire bien qu’ils en aient les capacités.
Dans la théorie du gène égoïste, les animaux régulent les naissances en fonction du nombre de petits qu’ils peuvent élever et non de l’intérêt général. Les gènes conduisant à avoir trop de descendants dont la plupart mourront rapidement se transmettront par définition plus mal que ceux qui permettent d’atteindre l’optimum. Par ailleurs, les individus qui renoncent à la reproduction faute de territoire ou de position sociale, s’accouplent finalement lorsqu’ils arrivent à prendre possession d’un territoire à l’occasion de la mort de son propriétaire initial. Le renoncement apparent, issus de la conclusion que tout nouveau combat serait une vaine perte de temps et d’énergie, n’est en fait que l’attente d’une occasion favorable et non un renoncement au profit du groupe.
Le gène égoïste – Résumé – Richard Dawkins
L’investissement parental peut se définir comme tout investissement fait par un parent sur un enfant qui augmente les chances de survie de l’enfant (et donc son succès en matière de reproduction) au prix pour le parent de sa capacité d’investissement sur d’autres enfants. L’investissement parental sur un individu se mesure donc en unité de diminution d’espérance de vie des autres petits, nés ou à naitre. La mère dont la parenté génétique avec chacun de ses enfants est de 1/2 veut répartir entre eux son investissement parental de manière équitable. Toutefois, chaque enfant partage avec lui-même une parenté de 1 et avec ses frères et sœurs une parenté de 1/2. En théorie, il voudra obtenir pour assurer la survie de ses gènes, entendus comme informations génétiques contenues dans son propre corps et sous forme de copies dans les corps de ses frères et sœurs, une part de l’investissement parental deux fois supérieur à celui des autres membres de la fratrie mais pas plus. Au-delà, la survie de ses gènes ne seraient pas optimisée compte tenu du préjudice subi par les copies.
Un tel raisonnement appliqué aux parents conduirait à ce qu’ils investissent deux fois moins sur leurs enfants que sur eux-mêmes. Mais comme évoqué précédemment d’autres facteurs interfèrent avec cette logique fondée sur la proportion de gènes communs : les enfants constituent de meilleures opportunités pour la survie des gènes à condition qu’ils fassent l’objet de soins. Ainsi les gènes correspondant à l’altruisme parental ou conduisant à s’occuper d’un membre de sa famille plus jeune et plus faible se transmettront et se concentreront dans le pool génique. Ils pourront aussi conduire un individu a avoir une attitude parentale envers ses frères et sœurs plus jeunes que lui.
Un conflit naît de la différence entre, d’une part, ce qu’un parent est prêt à investir sur un enfant qui correspond à une répartition équitable de l’investissement global entre l’ensemble de ses petits et, d’autre part, ce qu’un individu attend de ses parents en terme d’investissement qui correspond au double de ce qui est accordé à ses frères et sœurs. Chaque petit est alors prêt à mentir et à tricher pour bénéficier d’une plus grande part de l’investissement parental.
Le sevrage donne un exemple de ce conflit. Une mère veut sevrer un de ses petits pour pouvoir allaiter le suivant. Mais le premier ne renonce à l’allaitement que lorsque que son bénéfice à disposer du lait maternel, nourriture riche et disponible, atteint la moitié du bénéfice qu’en tirerait son frère ou sa sœur.
Toutefois, l’investissement parental n’est pas systématiquement distribué de la même façon. Une mère peut refuser de nourrir un enfant trop chétif qui nécessite pour survivre un investissement parental si important qu’il est susceptible de mettre en danger les autres petits de la portée et leurs capacités à transmettre leurs gènes. Toujours dans le but d’optimiser la transmission des gènes, elle peut laisser les plus grands trouver seuls leur nourriture pour allaiter le plus petit. Ces comportements permettent également aux gènes qui leur correspondent de prospérer, ceux conduisant à des comportements différents se raréfient.
Dans le même ordre d’idée, la ménopause est apparue suite à la baisse de l’efficacité de la procréation liée au vieillissement des femmes. Lorsque, pour cette raison, les chances de ses enfants à naître (qui portent la moitié de ses gènes) d’atteindre l’âge adulte sont devenues inférieures à la moitié de celles de ses petits enfants (qui portent le quart de ses gènes), une mère a intérêt à cesser de procréer et à s’investir dans ses petits enfants. Du point de vue génétique, si une femme ayant dépassé l’âge précité porte un gène l’incitant à arrêter de procréer pour s’investir dans ses petits enfants, il se retrouvera chez le quart de ces derniers dont les chances de devenir adultes sont plus de deux fois supérieures à celles des enfants qu’elle serait susceptible de mettre au monde. Si une femme du même âge porte le gène concurrent l’incitant à continuer de procréer, il se retrouvera chez la moitié de ses enfants dont les chances de devenir adultes sont plus de deux fois inférieures à celles de ses petits enfants. Ce second gène deviendra donc plus rare que le premier dans le pool génique. Ainsi, les gènes conduisant les femmes à la stérilité après un certain âge ont pu prospérer.
Le gène égoïste – Résumé – Richard Dawkins
La bataille des sexes trouve son origine dans la taille des gamètes. Les organismes primitifs possédaient des cellules sexuelles identiques. Les plus grosses, contenant le plus d’éléments nutritifs, furent favorisées par l’évolution. Cette tendance rendit possible l’apparition de gamètes plus petits, plus mobiles et produits en plus grandes quantités qui ne pouvaient survivre qu’à la condition de fusionner avec un gamète plus gros pour profiter de ces atouts. La différenciation entre les deux types de gamètes s’est amplifiée pour aboutir, d’une part, aux ovocytes, gros, peu mobile, chargés en éléments nutritifs et coûteux en ressources pour l’individu producteur qui ne peut les fabriquer qu’en faible quantité, d’autre part, les spermatozoïdes, petits, mobiles produits en grand nombre mais dotés d’une faible autonomie.
Quelle est la « bonne » proportion entre les mâles et les femelles ? Si un gène mutant interdisant aux femelles d’avoir des fils apparaissait, il se répandrait rapidement. Les mâles restant seraient néanmoins en mesure de perpétuer l’espèce. Ils auraient alors une nombreuse descendance en s’accouplant avec beaucoup de femelles différentes dont chacune n’aurait qu’une progéniture limitée. Les gènes issus des mâles, plus fertiles, se répandraient jusqu’à une égalité entre les deux sexes. La proportion égale entre les filles et les garçons à la naissance est évolutionnairement stable.
Chaque partenaire d’un couple est certes d’accord pour avoir des filles et des garçons en nombre égal mais chacun souhaite s’investir le moins possible dans leur éducation afin de pouvoir se reproduire à nouveau et poursuivre la transmission de ses gènes. Toutefois, la production d’ovocytes étant plus couteuse pour la femelle et constituant un investissement plus important que pour le mâle qui peut facilement changer de partenaire, c’est elle qui aura le plus à perdre si les petits ne sont pas élevés. Elle s’investira donc davantage pour eux. En outre, il ne sera intéressant pour le père de quitter sa partenaire que lorsqu’elle pourra élever seule ses petits avec une bonne chance de survie de la plupart d’entre eux. L’investissement du père varie donc selon les espèces d’une complète absence à un partage équitable des tâches. Enfin la femelle abandonne rarement son partenaire avec sa progéniture dans la mesure où les risques que le père les abandonne à son tour sont importants compte tenu de sa facilité à se reproduire à nouveau.
Face au risque de se retrouver seule et en difficulté pour élever ses petits, la femelle peut mettre des conditions à la copulation en adoptant une des deux stratégies que sont le bonheur conjugal et le mâle dominant. Le choix dépend des circonstances écologiques dans lesquelles se trouve l’espèce. Il n’est en outre pas exclusif et des choix intermédiaires sont envisageables.
La stratégie du bonheur conjugal consiste a faire durer la période prénuptiale de façon à obliger le mâle à s’investir dans la relation par exemple en construisant un nid ou en nourrissant la femelle, actions nécessitant du temps et de l’énergie. La femelle est alors rassurée sur les intentions et le caractère de son prétendant qui a fait preuve de constance, laissant supposer qu’il l’aidera à élever leurs petits. Toutefois, le succès de cette stratégie dépend de l’attitude des autres femelles car si un mâle peut se reproduire avec des partenaires plus promptes à céder, il cessera de s’intéresser aux plus exigeantes. Il semble ne pas exister de stratégie évolutionnairement stable dans ce domaine mais des variations permanentes du type : dans un contexte général de stratégie de bonheur conjugal, celles qui cèdent plus vite sont favorisées et transmettent leurs gènes. Les gènes correspondant à cette pratique se répandent. Compte tenu du manque de discernement dans le choix des mâles, de plus en plus de femelles doivent élever seules leurs petits, dont le taux de survie se trouve réduit. La capacité de ces mères célibataires à se reproduire est également plus faible que celles des tenantes du bonheur conjugal dont les gènes vont à nouveau se répandre à nouveau…
La stratégie du mâle dominant consiste pour la femelle à chercher non pas un père attentionné pour ses enfants mais les marques visibles des gènes correspondant à une longévité et une fécondité maximales. La femelle cherchera ainsi à optimiser la transmission de ses gènes en s’accouplant avec un partenaire présentant des marques de bonnes santé et de force afin de donner naissance à un beau mâle qui les possèdera aussi et qui suscitera à son tour un vif intérêt auprès de nombreuses femelles.
Cette sélection sexuelle pourrait conduire à atteindre un équilibre stable dans lequel tous les mâles auraient les qualités recherchées. Deux hypothèses permettent de justifier le fait que cet équilibre n’est pas atteint :
- les mutations génétiques qui atteignent certains des gènes responsables de ces caractéristiques,
- les parasites et les maladies qui modifient les critères de bonne santé et de longévité.
Certaines caractéristiques physiques telles que le long appendice caudal de l’oiseau de paradis sont vraisemblablement apparues pour mettre en évidence la bonne santé des individus. Les diarrhées étant chez les oiseaux des signes courants de maladie, une queue propre traduit une bonne santé. Si cet appendice est long et propre, cette santé n’en est que plus explicite. Plus généralement, la théorie du handicap de Zahavi affirme que des animaux ont développé des caractéristiques physiques handicapantes, telles que la queue chez les oiseaux de paradis ou les bois chez les cerfs, afin de montrer la qualité de leur constitution, donc de leurs gènes, par une aptitude à vivre malgré leurs désavantages physiques. L’évolution a parallèlement favorisé chez les femelles les gènes du goût pour de tels handicaps.
Les considérations précédentes permettent d’interpréter les principales différences entre les mâles et les femelles à la lumière de la théorie de l’évolution :
- Les mâles présentent souvent des couleurs plus vives causant des pressions de sélection conflictuelles : elles attirent les prédateurs mais sont sexuellement attirantes pour les femelles. La balance penche du côté de la sexualité : compte tenu de leurs capacités de reproduction les mâles n’ont pas besoin de vivre très vieux pour transmettre leurs gènes.
- Les femelles sont plus sélectives dans le choix de leurs partenaires : cette attitude est liée au plus gros investissement que représente pour elles la procréation. Il s’agit également d’éviter les hybridations avec d’autres espèces donnant naissance à un petit stérile tel que la mule, résultat du croisement d’un âne et d’une jument, ou les accouplements incestueux susceptibles de générer des maladies génétiques graves.
Le gène égoïste – Résumé – Richard Dawkins
Après les relations familiales examinons les relations intra et inter-espèce. Le tropisme pour la vie en communauté est répandu chez les animaux parce que chaque individu en tire un bénéfice.
On peut définir, pour un animal, le domaine de danger comme l’espace dans lequel un prédateur sera plus proche de lui que de n’importe quel autre congénère. La vie en troupeau constitue une réponse géométrique de certaines espèces pour réduire cette emprise sauf pour les individus qui se trouvent en périphérie. Un mouvement permanent s’opère donc dans le troupeau, des bords vers le centre.
Lorsqu’à l’approche d’un prédateur, un membre d’un groupe d’oiseaux crie, on peut penser de prime abord qu’il met sa vie en danger pour le bien commun. Plusieurs explications peuvent être apportées à ce comportement. Tout d’abord, la sélection par la parenté peut le justifier. En permettant au groupe de se mettre à l’abri, le crieur protège les copies de ses gènes présents dans les corps des individus qui lui sont apparentés. En outre, son intérêt égoïste est de prévenir ses congénères, si possible avant que le prédateur n’ait repéré le groupe, et que tous puissent se mettre à l’abri en même temps. Il garde ainsi le bénéfice du nombre qu’il aurait perdu lors d’une fuite solitaire. En revanche s’il ne réagit pas, le groupe risque d’être repéré et chacun de ses membres exposé au danger. Enfin, le son du cri d’alarme a évolué pour devenir difficilement localisable par un prédateur, ce qui limite voire supprime l’exposition de celui qui le pousse. Un individu tire donc un intérêt égoïste à donner l’alerte à l’approche d’un prédateur, même si le groupe entier en bénéficie.
Dans un troupeau de gazelles, à l’approche d’un fauve, l’une d’elle semble donner l’alarme en sautant très haut. Contrairement à une interprétation répandue un tel comportement peut se justifier non pas comme un acte de sacrifice au profit des autres individus du troupeau mais comme un message de bonne santé en direction du prédateur, l’invitant à choisir une autre proie moins alerte.
Ces comportements ne résultent pas de calculs cyniques mais de l’évolution. Ces gènes ont été sélectionnés parce que qu’ils confèrent à ceux qui les possède plus de chances de se reproduire.
Chez les insectes sociaux on peut être surpris par l’instinct de sacrifice de certains individus qui en piquant, perdent la vie pour défendre un bien tel que le miel ou plus généralement la communauté.
Chez les abeilles, les fourmis et les guêpes, appelées hyménoptères et qualifiées d’haplodiploïdes, seule la reine se reproduit. Les autres individus, bien que dotés d’un patrimoine génétique équivalent sont stériles. Une jeune abeille appelée à devenir reine quitte un jour de la colonie, accompagnée de nombreuses ouvrières, pour un vol nuptial au cours duquel elle recevra pour toute sa vie les spermatozoïdes du mâle d’un autre groupe. Lorsqu’elle fonde sa propre ruche, elle va pondre des œufs régulièrement. Les œufs fécondés par les spermatozoïdes du mâle avec qui elle se sera accouplée donneront des femelles, les œufs non fécondés des mâles. Ainsi, les mâles n’ont pas de père et ne dispose que d’un seul ensemble de gènes transmis par leur mère. Il fabriquent donc des spermatozoïdes identiques entre eux. En conséquence, les abeilles sœurs partagent 100 % des gènes de leur père et 50 % de ceux de leur mère. Leur parenté est donc de 3/4 et non de 1/2 comme habituellement entre sœurs. En revanche la parenté entre une sœur et un frère n’est que de 1/4 puisque le mâle ne reçoit ses gènes que de la mère. La parenté mère fille et mère fils reste de 1/2. Ainsi la parenté entre sœurs est supérieure à la celle entre parents et enfants. Les abeilles femelles ont donc intérêt pour optimiser la transmission de leurs gènes à exploiter la reine, leur mère, en limitant autant que possible le nombre de mâles, moins efficace pour cette transmission. Un conflit apparait : pour les ouvrières, le taux stable des naissances est de 3 sœurs pour un frère alors que pour la reine, il est d’un garçon pour une fille. Il s’ensuit des stratégies élaborées pour tromper la partie adverse. La mère peut rendre les œufs indifférentiables par l’odeur ou utiliser des esclaves pour s’occuper des œufs. Il devient alors impossible aux esclaves de s’adapter aux changements de stratégie adoptée par la mère pour sauver les mâles.
Chez les termites qui ne sont pas haplodipoïdes, le comportement altruiste s’explique par le fait que lorsque le roi ou la reine meurt, c’est un descendant qui prend la suite. Ces rapports incestueux conduisent à une homogénéité génétique du groupe et permettent une transmission efficace des gènes de chaque individu, même s’il n’est pas lui-même géniteur. Enfin, des mammifères présentant des comportements analogues aux insectes sociaux ont été découvert récemment. Il s’agit d’une taupe appelée spalax nu.
La théorie du gène égoïste fonctionne donc bien pour expliquer des comportements altruistes susceptibles d’être interprétés de prime abord comme une forme de sélection par le groupe. Dans tous les cas cités l’optimisation de la transmission des gènes constitue l’élément clé qui permet d’expliquer les comportements animaux.
Le gène égoïste – Résumé – Richard Dawkins
Il peut exister d’autres réplicateurs que les gènes. Les mèmes en sont un exemple. Il s’agit de réplicateurs d’ordre culturel et non plus chimique. Ainsi il peut s’agir de mélodies, d’idées, de techniques, de modes… Si on en trouve de façon ponctuelle et anecdotique dans le règne animal, par exemple sous forme de nouveaux chants qui apparaissent et perdurent au fils des générations chez certains oiseaux, les mèmes se trouvent essentiellement chez l’homme. En passant de cerveau en cerveaux par un processus d’imitation, ils se répliquent et mutent du fait notamment des interprétations que leur font subir certains de leurs hôtes. Ils sont ainsi l’objet d’une sélection semblable à celle qui s’appliquent aux gènes mais de façon accélérée. Certains disparaissent, d’autre se répandent selon des critères de survie identiques à ceux des gènes : longévité, fécondité et fidélité de la copie.
On peut s’interroger sur la complexité de l’information contenue dans un mème : correspond-il à une symphonie, à un de ses mouvement, à un accord ou à une note ? La théorie de Darwin a été remaniée à tel point qu’aujourd’hui, il la reconnaitrait à peine. Pourtant les darwinistes actuels hébergent encore dans leur cerveau une partie de la théorie initiale. De la même façon qu’un gène pouvait être défini comme une portion de matériel chromosomique ayant une bonne probabilité de stabilité pendant de nombreuses générations, les mèmes correspondent à des séquences de culture. Au cours du processus de transmission, ces séquences peuvent parfois être coupées pour être réagencées. Comme les gènes, les mèmes s’entoureront progressivement d’autres mèmes avec lesquels ils pourront coopérer et former un complexe mémique. Par exemple l’idée de Dieu coopère étroitement avec la peur de l’enfer, chacun renforçant l’autre. La foi, consistant à croire sans chercher de preuves, appartient au même complexe. L’attrait psychologique constitué du soulagement qu’ils procurent ainsi que leur simplicité ont permis à ces mèmes de prospérer.
Dans certains cas, les réplicateurs que sont les mèmes contrarient les desseins des réplicateurs que sont les gènes. Par exemple la règle du célibat des prêtres peut se transmettre dans le complexe mémique religieux en s’opposant à la réplication des gènes qui nécessité la fabrication de nouvelles machines à survie.
Les hommes sont ainsi sous la double influence des gènes et des mèmes. Ils disposent toutefois d’une vision du futur et d’un libre arbitre, inconnus dans le reste du monde animal, qui leur permettent de ne pas agir de façon à satisfaire des pulsions égoïstes visant à procurer un bénéfice immédiat comme les gènes ou les mèmes les y invitent. Ils peuvent opter pour un égoïsme dont les effets sont différés et plus durables, voire se rebeller par des actions purement altruistes.
Le gène égoïste – Résumé – Richard Dawkins
L’altruisme réciproque entre plusieurs individus peut s’étudier à partir de la théorie des jeux et en particulier du dilemme du prisonnier. Il s’agit d’un jeu comprenant un banquier qui distribue des points et deux joueurs disposant chacun de deux cartes : déserter et coopérer. Les joueurs jouent en même temps, sans savoir à l’avance ce que l’autre va jouer. Les scores sont distribués de la façon suivante :
| Joueur B coopère | Joueur B déserte | |
| Joueur A coopère | A : 3 points – B : 3 points | A : 0 point – B : 5 points |
| Joueur A déserte | A : 5 points – B : 0 points | A : 1 point – B : 1 point |
Le nombre de points n’est pas important. Seul importe l’ordre des récompenses et le fait que la moyenne des points de la situation constituée d’une coopération et d’une désertion soit inférieure à la coopération mutuelle. Un joueur qui coopère peut espérer 3 points si l’autre coopère, 0 s’il déserte. Un joueur qui déserte peut espérer 5 points si l’autre coopère, 1 point s’il déserte. Sur un pli, un joueur rationnel jouera donc déserter.
Ce jeu tire son nom du fait qu’il traduit le dilemme que rencontrent deux accusés, coupables d’un méfait. S’ils coopèrent entre eux en se taisant, ils seront très légèrement condamnés car un fort doute subsistera. Ce résultat correspond à 3 points dans le jeu. S’ils désertent et se dénoncent mutuellement, ils seront lourdement condamnés mais avec une certaine mansuétude liée à leurs aveux. Cela correspond à 1 point. En revanche, si l’un déserte en dénonçant son complice et que celui-ci coopère en se taisant, le dénonciateur sera mis hors de cause et acquitté alors que son complice sera lourdement condamné. Ces résultats correspondent respectivement à 5 et 0 points.
L’exercice peut être répété un certain nombre de fois pour constituer le jeu du dilemme du prisonnier itéré. Il est alors possible d’adopter des stratégies de façon à bénéficier d’une coopération mutuelle au dépend du banquier qui distribue les points. Il s’agit là d’un jeu à somme non nulle pour les participants contrairement aux jeux dans lesquels ce que gagne l’un, l’autre le perd. Dans le jeu itéré, toutes les combinaisons sont possibles : toujours déserter, déserter une fois sur dix et coopérer le reste du temps, toujours coopérer… Celles commençant par coopérer sont qualifiées de gentilles, les autres de méchantes. Celles qui oublient rapidement les désertions de l’adversaire et ne les font pas payer par une longue suite de désertions sont qualifiées de clémentes. Celles qui essaient de faire de bons scores sans vouloir faire plus que l’adversaire sont qualifiées de non-envieuses. Des tournois ont été réalisés. Chaque participant élabore une stratégie a priori, sans possibilité d’intervenir lors du jeu qui se déroule de façon informatisée. Chaque stratégie affronte toutes les autres ainsi qu’elle-même. Le premier tournoi du genre, opposant quinze stratégies, a été remporté par le donnant donnant consistant à coopérer au premier pli puis à jouer la même chose que le précédent coup de l’adversaire. Au fil des tournois, de nombreuses possibilités ont été testées telles que le donnant pour deux donnantsconsistant à ne jouer déserter qu’après deux désertions de l’adversaire. Il faut noter que la fortune de chaque stratégie est liée aux autres stratégies présentes et que le résultat n’est pas compté en nombre de manches remportées mais en nombre de points marqués lors de l’ensemble des manches. D’une façon générale, on note que les stratégies ditesgentilles mais capables de riposter, clémentes et non-envieuses font les meilleurs scores et que les bons finissent les premiers.
Un autre tournoi a été organisé en ne distribuant plus des points mais des descendants. Les stratégies gentilles mais capables de riposter, clémentes et non-envieuses ont encore fait les meilleurs résultats alors que d’autres ont disparu. Aucune toutefois n’a pu être qualifiée d’évolutionnairement stable c’est-à-dire capable de bien s’en sortir lorsqu’elle est partagée par un nombre suffisant de participants. Le donnant donnant ressemble à une SES mais peut être envahie par toujours coopérer dont elle ne se distinguera pas, qui pourra à son tour être envahie par toujours déserter.
Il est également important dans le jeu itéré que les participants ne connaissent pas le nombre de plis. S’ils disposaient de cette information, ils déserteraient systématiquement au dernier coup conformément à leur intérêt. Mais ce dernier résultat étant connu, ils feraient la même chose au précédent et la partie se résumerait à des désertions mutuelles.
De nombreuses illustrations de ces stratégies existent dans la vie et le monde animal :
- un couple qui divorce arrive souvent grâce à ses avocats à une somme nulle : ce que perd l’un, l’autre le gagne. En revanche, les avocats coopèrent et s’enrichissent au dépend du couple jouant le rôle de banquier,
- dans certaines circonstances les soldats de la première guerre mondiale ont fraternisé c’est-à-dire joué coopérer au dépend des généraux qui voulaient les voir jouer déserterc’est-à-dire combattre. La stratégie utilisée, proche de donnant donnant peut être qualifiée de vivre et laisser vivre,
- dans le monde animal, on observe que chez des communautés de chauves-souris, celles qui ont pu ingérer beaucoup de sang dans une nuit en régurgite pour le donner à celles, moins chanceuses, qui sont rentrées bredouilles et risquent de mourir de faim. Cette pratique qui atténue le facteur chance peut être considérée comme une coopération mutuelle entre individus permettant à tous d’en tirer profit à tour de rôle.
Le gène égoïste – Résumé – Richard Dawkins
Introduction à la théorie du phénotype étendu
Il existe un paradoxe dans le fait que la loterie de la méiose, par la réunion aléatoire de gènes, conduise à un individu cohérent. Ainsi se pose la question de la portée d’un gène c’est-à-dire de ses effets phénotypiques. Traditionnellement, cette portée ne s’envisage que sur le corps du porteur. La théorie du phénotype étendu élargit cette vision en prenant en considération l’ensemble des effets qu’il produit sur le monde.
De nombreux exemples montrent que les effets phénotypiques dépassent le cadre du corps des individus et peuvent concerner :
la matière :
- les larves des mouches phryganes qui vivent dans le lit des rivières construisent des abris tubulaires mobiles avec des pierres choisies pour leur géométrie parfaitement adaptée à l’ouvrage. La sélection darwinienne a ainsi permis l’émergence du caractère phénotypique étendu constitué par les caractéristiques de ces abris,
- les lacs produits par les barrages des castors selon des caractéristiques précises sont des effets phénotypiques des gènes au même titre que les dents de ces animaux,
ou le vivant :
- des parasites de l’escargot, appelés trématodes, conduisent leurs hôtes a fabriquer une coquille plus épaisse. Les gènes du parasite ont un effet phénotypique consistant dans la sécrétion et la transmission à son hôte d’une substance chimique spécifique, ainsi qu’un effet phénotypique étendu sur l’escargot consistant dans la formation d’une coquille plus épaisse. En outre, si cette coquille est plus protectrice et permet un allongement de l’espérance de vie de l’escargot, elle nécessite une énergie supplémentaire qui fera défaut à ses capacités reproductrices. L’équilibre initial est ainsi déplacé vers la longévité au détriment de la reproduction,
- les larves des escarbots de la farine sont parasitées par des protozoaires appelés nosema qui sécrètent et injectent dans le corps de leur hôte l’hormone juvénile produite naturellement par la larve et dont l’arrêt permet son passage à l’état adulte. La présence de cette hormone dans l’individu au-delà de l’âge normal le maintien à l’état de larve dont la taille augmente démesurément. Le nosema a appris au cours de son évolution à produire l’hormone qui lui permet de prolonger sa présence dans son hôte qui subit ainsi l’effet phénotypique étendu de gènes du parasite,
- les gènes du coucou responsables de l’effet phénotypique consistant dans le rouge de la gorge des petits ont un effet phénotypique étendu sur le comportement des oiseaux qui les nourrissent au détriment de leur propre progéniture. Ils se laissent berner, comme drogués par cette couleur, malgré l’absence évidente de tout lien de parenté. Il s’agit là d’un exemple de phénotype étendu à distance.
Les parasites des escargots et des larves d’escarbots transmettent leurs gènes par des voies différentes de celles de leurs hôtes dont ils ne chercheront qu’à allonger la vie dans l’état qui leur est favorable sans se soucier de leurs capacités de reproduction. En revanche, le parasite favorisera sa propre reproduction en agissant sur son hôte : le virus de la grippe fait éternuer ou tousser ce qui permet de contaminer de nouveaux malades, le virus de la rage conduit un chien à mordre et à parcourir des distances anormalement importantes lui permettant de se répandre sur un grand périmètre. Dans le même esprit, bien qu’aucune étude n’ait été entreprise sur la question, il ne serait pas étonnant que les maladies sexuellement transmissibles augmentent la libido de leurs victimes.
En revanche, les escarbots perce-bois sont parasités par des bactéries qui se transmettent dans leurs œufs. La capacité de reproduction des escarbots présentant un intérêt pour toutes les parties, elle restera intacte. Dans de tels cas, les espèces coopèrent. Elles peuvent finir par se confondre et leur matériel génétique par se mélanger. De nombreuses espèces y compris l’homme, sont vraisemblablement les produits de tels mélanges.
On s’aperçoit que les effets phénotypiques étendus foisonnent dans le règne animal. Les gènes manipulent le monde pour assurer leur propagation sans que les corps dans lesquels ils se trouvent ne constitue une frontière réelle pour leur influence. Ce principe peut être énoncé dans le théorème central du phénotype étendu : le comportement d’un animal tend à optimiser la survie des gènes responsables de ce comportement qu’ils soient ou non dans le corps de cet animal. (An animal’s behaviour tends to maximize the survival of the genes for that behaviour, whether or not those genes happen to be in the body of the particular animal performing it).
L’intérêt des biologistes se porte sur trois principaux niveaux que sont le gène, l’individu et le groupe. Il convient de distinguer le statut de réplicateur du gène de celui de véhicule qui peut être attribué au groupe ou à l’individu. Toutefois, ce dernier est une entité cohérente présentant la caractéristique essentielle de permettre à chaque gène de le quitter par une même porte de sortie constituée des cellules sexuelles, à l’issue d’une loterie équitable, la méiose. Un groupe d’individus ne présente généralement pas cette possibilité et ne peut donc être considérer comme véhicule. Une colonie d’insectes tels que les abeilles présente toutefois cette caractéristique pour les raisons indiquées précédemment et peut être, à ce titre, considérée comme un individu intégré.
Mais pourquoi les gènes se sont-ils regroupés dans de grands corps à sortie unique ? Tout d’abord, la formation de cellules a permis aux gènes de coopérer dans un milieu fini, capable d’héberger des réactions chimiques et d’en confiner les différents produits. Ces cellules sont restées collées les unes aux autres après les premières divisions. Une fois les organismes multicellulaires apparus, certains ont évolué vers des êtres vivants de plus grandes tailles pour survivre dans un monde saturé par les petits organismes en créant un début de chaîne alimentaire. Plus encore, cette évolution a permis à des cellules contenant toutes les mêmes gènes de se spécialiser et d’augmenter l’efficacité de l’individu qu’elles constituent au bénéfice de ses gènes. Les cycles de vie qui se sont alors établis commencent par un ovocyte fécondé pour finir par des cellules sexuelles. Ainsi, le trait essentiel qui caractérise un organisme individuel est qu’il s’agit d’une unité qui commence et finit dans un goulot d’étranglement unicellulaire. Ce schéma qui débute par une cellule œuf et finit par une cellule sexuelle présente plusieurs avantages :
- les cellules n’héritent pas directement des organes des parents mais de leur patrimoine génétique qui est remodelé pour donner un nouveau mélange et permettre des améliorations,
- le processus de croissance des individus à partir d’une cellule œuf permet de donner un calendrier de développement et d’entrée en action des différents gènes permettant le déroulement des étapes nécessaires à la constitution d’organes complexes tels que l’œil,
- le maintien de la cohérence d’un individus par le fait que le patrimoine génétique de ces cellules ne diffèrent que par les mutations récentes. Les gènes vont donc poursuivre leur coopération et la sélection naturelle continuera d’agir. En revanche un système de reproduction de type bouturage conserve les mutations passées qui ont pu se produire dans les nombreuses cellules de la bouture, faisant perdre progressivement son unité génétique à la plante obtenue.
Les cycles de vie présentant à leurs extrémités un goulot d’étranglement unicellulaire semblent donc aller de paire avec la constitution d’organismes individuels dans lesquels s’expriment les avantages précités.
Le gène égoïste – Résumé – Richard Dawkins
ANNEXE – Idées et notions clés
- Théorie du gène égoïste : les gènes sont des réplicateurs, héritiers des premiers d’entre eux apparus dans la soupe originelle présente sur la Terre avant l’apparition de la vie, qui ne visent, par des processus chimiques excluant toute conscience, qu’à se reproduire et qui ont pour ce faire évolué de façon à construire des machines à survie de plus en plus sophistiquées et performantes que sont les êtres vivants du règne animal et végétal. Dans cette compétition, la sélection naturelle a favorisé les réplicateurs puis les gènes les plus habiles et les plus efficaces à se répandre.
- Stratégie évolutionnairement stable (SES) : une SES est une stratégie qui, si elle est adoptée par la majorité des individus ne peut être améliorée par aucun individu mutant.
- Illustration simple du concept de SES : une population hypothétique est composée d’individus agressifs, les faucons, et d’individus pacifistes, les colombes. L’issue de chacune des possibilités de rencontres entre les oiseaux est indiquée sur le tableau si après, accompagnée des scores destinés à la modélisation selon le barème suivant : combat gagné : 50 points, combat perdu : 0 point, perte de temps : -10 points, blessure : -100 points. Ces points traduisent en fait les capacités de survie des gènes pour les générations suivantes :
| Rencontres | Colombe | Faucon |
| Colombe | Intimidation prolongée sans combat des deux adversaires avant que l’une d’elle ne quitte la scène.
Chaque colombe gagne 1 opposition sur 2. Colombe vainqueur : 50 – 10 = 40 pts, Colombe perdante : – 10 pts. |
Fuite immédiate de la colombe sans combat.
Colombe : 0 point, Faucon : 50 points |
| Faucon | Fuite immédiate de la colombe sans combat.
Colombe : 0 point, Faucon : 50 points |
Combat provoquant des blessures. Chaque faucon remporte 1 combat sur 2.
Faucon vainqueur : 50 points Faucon perdant : -100 points |
Soit c le nombre de colombes et f le nombre de faucons,
Le score moyen d’une colombe est : Sc =c/(f+c) x (1/2 x (-10) + 1/2 x (50-10)) + f/(f+c) x 0
Le score moyen d’un faucon est : Sf = c/(f+c) x 50 + f/(f+c) x (1/2 x 50 + 1/2 x (-100))
Si tous les membres de la population sont des colombes, leur score moyen par opposition sera de + 15. Mais, si un individu mutant adopte une attitude de faucon, il commencera par faire fuir toutes les colombes et son score moyen par combat sera de 50. Puis ses gènes se diffuseront et, au fil des générations, les faucons continueront à gagner face aux colombes mais perdront une fois sur deux face aux autres faucons.
Si tous les membres de la population sont des faucons, leur score moyen par combat sera de – 25. Mais, si un individu mutant adopte une attitude de colombe, son score moyen par combat sera de 0. Ses gènes se diffuseront donc mieux que ceux des faucons.
Ces deux extrêmes ne sont pas des SES. Une telle stratégie correspond en fait à une égalité des scores moyens par combat des faucons et des colombes impliquant des proportions respectives de 7/12 et 5/12. Une stratégie est une SES non-pas parce que c’est la meilleure pour les individus mais parce qu’elle est immunisée contre la trahison interne
- Théorie du phénotype étendu : la théorie du phénotype étendu élargit la prise en compte de la portée d’un gène à l’ensemble des effets qu’il produit sur le monde alors que traditionnellement, seuls les effets sur le corps du porteur du gène sont considérés.
- Théorème central du phénotype étendu : le comportement d’un animal tend à optimiser la survie des gènes responsables de ce comportement qu’ils soient ou non dans le corps de cet animal.

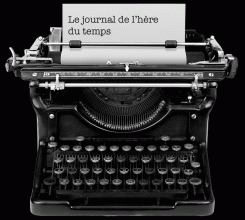
[…] théorie a été popularisée par le livre de Richard Dawkins Le gène égoïste, paru en 1976, qui connut un immense succès dans le monde anglo-saxon où il est aujourd’hui une […]
J’aimeJ’aime
[…] nature humaine – The Blank Slate – est pour ainsi dire une suite de l’ouvrage de Richard Dawkins Le gène égoïste. Toutefois, alors que Richard Dawkins s’en tenait aux comportements animaux, Steven […]
J’aimeJ’aime